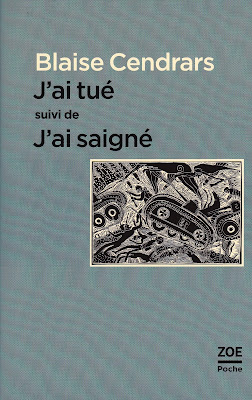Le
samedi 12 août 1916, Cocteau se rend à Montparnasse où il a rendez-vous avec
Picasso, muni de l’appareil photo Kodak de sa mère. On peut penser qu’il avait
le sentiment que cette journée pouvait être historique pour se munir ainsi d’un
appareil photo…
Peut-être
s’agit-il du jour où il propose au peintre de créer les décors et costumes du
ballet qu’il a en projet, Parade ?
C’est ce que pense Billy Klüver, auteur du magnifique Un jour avec Picasso. 21 photographies de Jean Cocteau. Et c’est
aussi ce que nous pensons, mais amis et moi. Cocteau se souvient :
« À Montparnasse, en 1916, l’herbe sortait encore entre les pavés… Les
marchands de légumes y poussaient leurs petites voitures. On palabrait au
milieu de la rue. C’est au milieu de la rue, entre la Rotonde et le Dôme, que
je demandais à Picasso de faire Parade. »
 |
| Un costume de Parade par Picasso |
Le
maître réserve sa réponse quelques jours, puis, le 24 août, Cocteau et Satie
écrivent une carte postale à Valentine Gross (chez qui le projet était
né) : « Picasso fait Parade
avec nous. »
Parade, commande de Diaghilev, argument
de Cocteau, musique d’Erik Satie, décors et costumes de Picasso. C’est un
tournant à plusieurs titres. Cocteau, élargissant ainsi son rayonnement au-delà
de ses cercles mondains, intègre la véritable avant-garde. Pour Satie, il
s’agit d’une forme de consécration. Et pour Picasso, un moyen de passer à autre
chose tant sur le plan personnel (il fait encore le deuil d’Eva) qu’esthétique
en élargissant ainsi sa pratique. Picasso assouvit ainsi sa passion du cirque
(familier de Médrano) : le nom même de « parade » renvoie à la
série de numéros qu’exécutent les gens du cirque à l’extérieur de l’enceinte
pour attirer les badauds sous le chapiteau. Il lui permet aussi de fondre en
quelque sorte son cubisme, ses collages (invention encore fraîche) au mouvement
de la danse. C’est pour connaître la troupe de Diaghilev et étudier les
mouvements des danseurs et danseuses que Picasso se rend à Rome, où il rencontrera la danseuse Olga, qui
deviendra sa femme. On ne mesure jamais assez la portée de certaines journées…
Ce
samedi se situe quelques jours après l’exposition organisée par André Salmon
Chaussée d’Antin, chez le couturier Paul Poiret, fameuse notamment parce que
c’est la première fois qu’une certaine toile de Picasso, qu’il appelait
« Le bordel philosophique » et que pour l’occasion Salmon baptise Les Demoiselles d’Avignon. Plusieurs des
personnes qui apparaîtront dans les photographies de cette journée
participaient à cette exposition : Moïse Kisling, Amedeo Modigliani, Marie
Vassiliev, Ortiz de Zárate, André Salmon et Picasso bien sûr. Serons aussi présent le poète
Max Jacob et le collectionneur et marchand d’art, futur auteur de Jules et Jim, Henri-Pierre Roché, qui a
notamment présenté Picasso aux Stein.
Quelques
semaines plus tard, c’est à quelques pas de là, rue Huyghens, que débutera la
série de Lyre et palette, dans
l’atelier du peintre Émile Lejeune, organisée par lui et Ortiz de Zárate,
qui mêlera peintures, dessins, sculptures, accompagnés de récitals de musique
et de poésie. Picasso, Modigliani, Cocteau, Cendrars, Satie qui chapeaute le
futur Groupe des Six… Encore un événement d’une infinie richesse, dont je
reparlerai plus tard. Notez tout de même que c’est en sortant de Lyre et palette que Zborowski décide de
prendre en charge Modigliani, lui assurant une subsistance, atelier, matériel,
couvert et modèles afin que l’artiste puisse enfin travailler tranquillement.
Par
ailleurs, pendant ce temps, certains grands absents de cette journée à Montparnasse
sont sur le front, Apollinaire notamment. Quant à Soutine, où était-il ?
Avec
quelques amis, nous avons décidé de fêter dignement cet événement le centenaire
de cette journée particulière et documentée.
Nous
avons tenu à être présent, exactement un siècle plus tard, avec la même
lumière, pour photographier ce qui a changé et ce qui demeure. Pur prétexte,
aussi, pour boire du champagne au pied du Monument
à Balzac (qui n’y était pas, installé seulement en 1939), à ce carrefour
voisin qui s’appelle, le savez-vous seulement ? Place Pablo Picasso !
Minutage
Pour
résumer, selon Klüver, Cocteau arrive entre 12h30 et 12h45. Il commence à
photographier ses amis Picasso, Max Jacob, Henri-Pierre Roché et Ortiz de Zárate
devant la Rotonde. Marie Vassilieff se joint à eux.
Picasso fait signe à Marie Vassilieff
Michael et Neville devant la Rotonde, vers 12h30. On remarque que l'étage ne faisait pas partie
de l'établissement en 1916
Vers
13h, ils vont déjeuner chez Baty, le restaurant d’huîtres et marchand de vin où
Apollinaire, entre autres, avait ses habitudes.
Ils
en sortent vers 14h15 pour aller prendre un café à La Rotonde où les rejoint
Pâquerette, maîtresse de Picasso et modèle chez le couturier Poiret et
l’artiste Moïse Kisling qui habite tout près, rue Joseph-Bara.
 |
| Ortiz de Zarate, Kisling, Jacob, Picasso et Pâquerette |
 |
| Les mêmes, Picasso et Pâquerette éclatent de rire |
 |
| Quelle est donc cette enveloppe que tient Picasso dans plusieurs de ces photos ? |
Arrivent
plus tard Modigliani, souriant, et André Salmon.
Nouvelles
séquences de photographies, devant la Rotonde avec des mises en scènes où
figurent Jacob et Kisling avec notamment une de ses voitures de légumes
qu’évoquait Cocteau, puis plus tard encore (15h30) sur les marches de l’église
Notre-Dame-des-Champs.
Mike devant l'église Notre-Dame-des-Champs
Un peu plus tard encore, devant le bureau des PTT.
Max Jacob lit-il un missel ?
Les
photos que nous avons prises (je n'en place que quelques-unes, il y en a une centaine) pourront toujours servir pour qui voudra de
témoin, de repère, d’éléments de comparaison sur ce qui était et sur ce qui
demeure. Nous tenions surtout à capter cette lumière centenaire, en cette très
belle journée de grand soleil : le hasard, dans sa logique bien à lui, a
bien voulu nous donner en ce vendredi 16 août 2016 le même grand soleil que le
samedi 16 août 1916 à la même heure (oui, l’heure d’été était effective en
France depuis le 15 juin 1916 !!!) et la même température (27°).
Sans respecter jusqu’au
fétichisme le déroulé de la journée (nous avons préféré déjeuner à La Rotonde),
Neville, Michael et Georges en terrasse de La Rotonde
sans vouloir non plus créer une reconstitution parfaite, sans vouloir faire de
mise en scène avec personnage, nous avons néanmoins tenu à jouer le jeu d’une
fête centenaire, à la fois sérieuse (captations photographiques aux mêmes
moments) et ludique.
Et pour quelques allumés de notre espèce, le souvenir d’une
journée festive, prenant prétexte d’un centenaire dont nous sommes bien rares à
nous émouvoir, célébrant aussi notre joie d’exister sur cette terre, sur cette
place de Montparnasse qui fut bien le centre du monde.